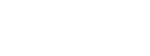LA MYELITE
LA MYELITE
- DÉFINITION
La myélite est une inflammation de la moelle épinière. Le terme également employé est celui de myélite transverse, le terme de transverse signifiant que cette atteinte se situe à un niveau précis de la moelle épinière.
C’est donc un sous ensemble des myélopathies, qui signifient « atteinte de la moelle épinière », sans préciser ni l’étendue de l’atteinte, ni le processus pathologique qui en est responsable.
Ce problème peut toucher aussi bien l’adulte que l’enfant.
On estime qu’il existe en France entre 60 et 300 cas en France, ce qui en fait une maladie rare.
- SIGNES
Les signes se développent soit de façon assez brutale et se complètent en quelques heures, soit de façon plus lente en quelques jours voire semaines.
L’inflammation étant généralement bas située dans la moelle épinière, les signes toucheront essentiellement les membres inférieurs. Dans un très rare nombre de cas, ces troubles touchent les membres supérieurs.
Ce sont généralement aussi bien les fibres motrices que les fibres sensitives qui sont touchées. La conséquence est donc :
Des sensations douloureuses ou de troubles de la sensibilité telles que des sensations de courant électrique, de toile d’araignée sur la peau, de picotements ou d’engourdissement des jambes.
Des douleurs au niveau de certains nerfs (douleurs équivalentes à une sciatique ou à une cruralgie.
Douleurs au niveau du dos.
Parfois ces sensations sont ressenties comme une sorte de corset un peu douloureux au toucher, qui enserrerait le corps.
Faiblesse dans les membres inférieurs, pouvant entraîner des paralysies variables des membres inférieurs : soit paralysie de certains muscles des jambes, soit paraplégie dans un petit nombre de cas.
Difficulté à contrôler les sphincters de la vessie et des intestins, responsable de fuites urinaires ou intestinales.
A cela peuvent s’ajouter des signes tels que :
- Fièvre
- perte d’appétit
- EVOLUTION
La maladie s’installe généralement en 1 à 3 mois. Au-delà de cette période, l’évolution est très variable en 2 à 12 semaines, voire plus (jusqu’à 2 ans) : soit récupération complète, soit récupération partielle, soit absence de récupération.
Dans un bon tiers des cas, la récupération est bonne. Quelques séquelles peuvent subsister, notamment en ce qui concerne les troubles de la sensibilité, ou de petites fuites urinaires.
Dans un autre tiers des cas, des séquelles plus marquées peuvent survenir : troubles de la marche et fuites urinaires ou intestinales.
Dans le dernier tiers des cas, en particulier lorsque le début a été brutal, les paralysies peuvent être définitives.
Dans de très rares cas, une récidive est possible, notamment s’il existe une pathologie sous-jacente qui est la cause de cette myélite.
- CAUSES
La myélite peut s’observer dans des maladies infectieuses, telles que herpès, infections à cytomégalovirus, mononucléose infectieuse, HIV , parfois grippe , rage , rubéole , varicelle , oreillons . La myélite est alors une complication rare de ces affections.
Autres causes : mycoplasme, maladie de Lyme, syphilis , tuberculose .
Suites de vaccinations contre la rage ou la variole.
Maladies auto-immunes, telles que le lupus érythémateux disséminé, syndrome de Gougerot-Sjögren , la sarcoïdose , ou la polyarthrite rhumatoïde .
Manifestations dans le cadre d’un cancer connu, ce qu’on appelle un syndrome paranéoplasique.
Sclérose en plaques
Thrombose artérielle au niveau d’une artère qui irrigue la moelle épinière. Cela se voit surtout chez les héroïnomanes.
Myélite idiopathique. C’est la cause la plus fréquente. Idiopathique signifie qu’on n’en connaît pas la cause. Toutefois, il est vraisemblable qu’il s’agisse d’un processus auto-immun, c’c’est à dire une réaction de l’organisme contre lui-même. Certaines hypothèses sont également envisagées, comme la réaction à une infection : un microbe pénètre dans l’organisme, et celui-ci se défend en fabriquant des anticorps pour le détruire. Mais si par malchance ce microbe possède à sa surface des antigènes qui ressemblent à certains porté par des cellules de la moelle épinière, les anticorps vont attaquer également la moelle épinière.
- L’ATTITUDE DU MÉDECIN
Sa première préoccupation est d’éliminer une tumeur de la région, un abcès, ou tout autre processus qui pourrait comprimer la moelle. C’est l’IRM qui fait le diagnostic. Lorsque celle-ci n’est pas possible à réaliser, on effectue une myélographie.
Des analyses de sang sont également effectuer pour retrouver l’une ou l’autre des causes citées.
La ponction lombaire est parfois utile pour retrouver une cause que les analyses de sang n’auraient pas pu révéler.
- TRAITEMENT
Il n’y a pas de traitement spécifique de la myélite. Les traitements ont pour but de diminuer les symptômes et leur mise en œuvre est faite dès les premiers signes :
Corticoïdes. On utilise généralement de la methylprednisone ou de la dexamethazone. Leur but est de freiner l’action du système immunitaire.
Des antalgiques sont proposés également contre les douleurs.
Le repos alité est essentiel, surtout dans les premiers jours.
La récupération est hâtée par la kinésithérapie pour renforcer la musculature, la coordination et l’étendue des mouvements.
Les psychothérapies de soutien sont indispensables pour aider la personne à surmonter les handicaps, surtout en début de maladie.
Dans les rares cas graves, une réanimation est nécessaire avec mise sous respirateur artificiel
Lors des suites de l’évolution et selon les handicaps, une aide médico-sociale est alors nécessaire.